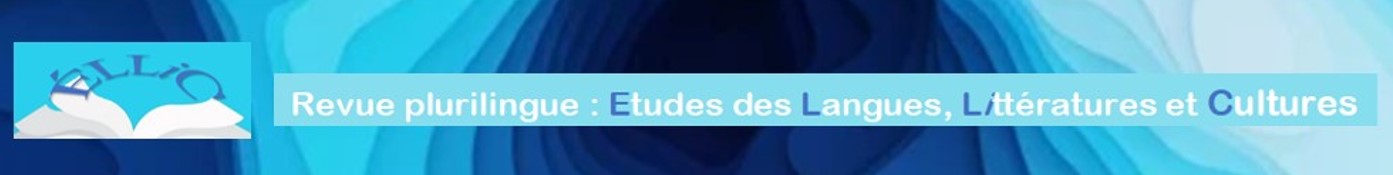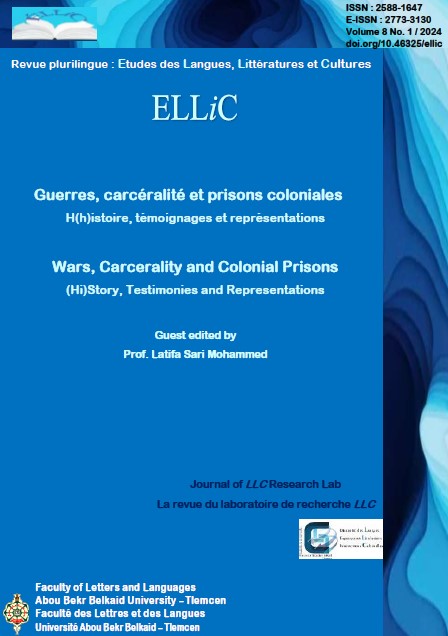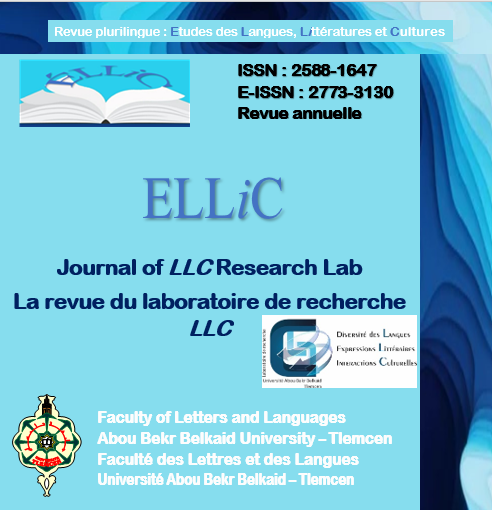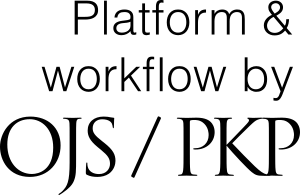La littérature à l'épreuve de la carcéralité coloniale
DOI:
https://doi.org/10.46325/ellic.v8i1.127الكلمات المفتاحية:
Littérature، Carcéralité، Algérie، Colonialisme، Témoignagesالملخص
La question de la carcéralité s'est posée et imposée en Algérie évoluant en parallèle de l'expansion coloniale. Les algériens écrasés par le « discours historique dominant » se sont emparés tardivement de la littérature pour exprimer leur souffrance. Enfants d'une culture locale malmenée, déchirés entre une tragédie collective et une mémoire individuelle, ils attendront le début des années 1950 pour s'exprimer. Le plus souvent en français.
A partir du soulèvement de 1954, émerge une autre littérature, si les écrivains écrivent toujours en français, ils sont moins dans le « mimétisme » et s'en tiennent à un récit factuel, à l'os, au plus près des événements et des réalités du terrain.
Ainsi, l'écrivain algérien en proie à un vif traumatisme s'empare-t-il de la littérature pour créer, inventer, avancer dans une structure qui place en son centre « la mémoire tatouée » selon le titre bien nommé d'Abdelkebir Khatibi.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Revue plurilingue : Études des Langues, Littératures et Cultures

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.